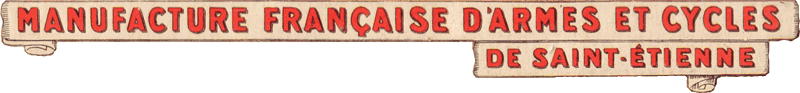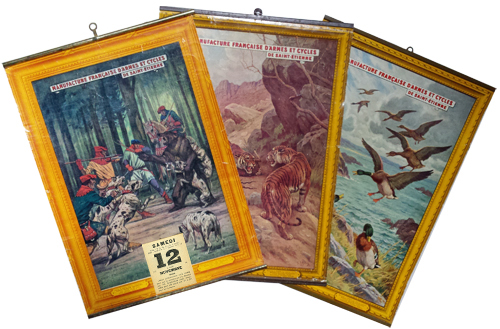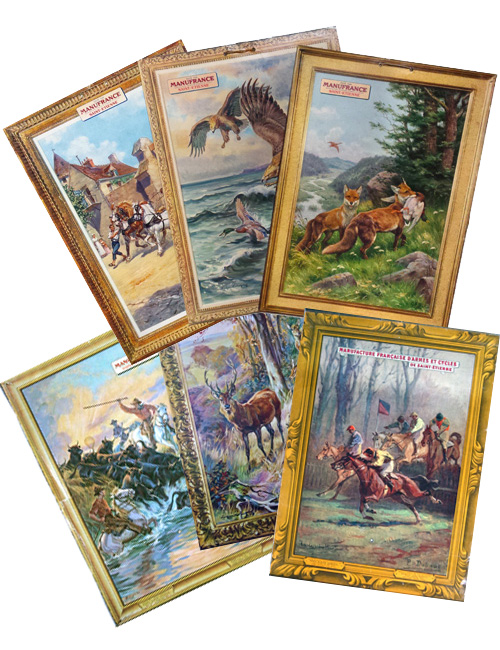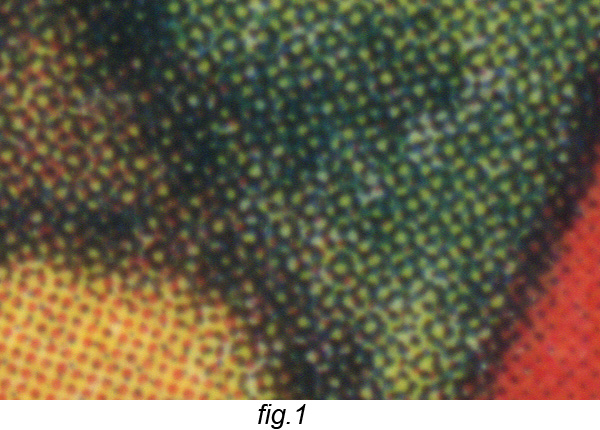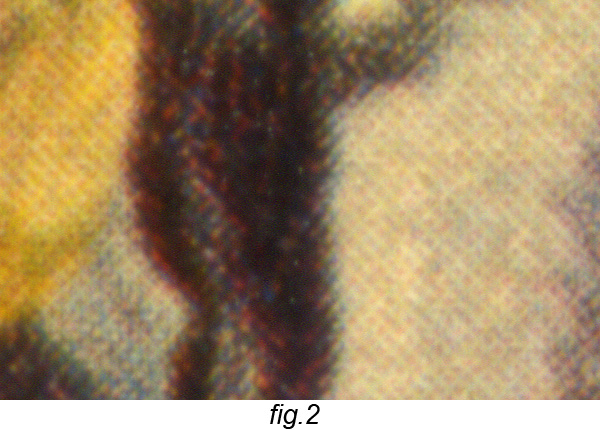|
||||||||||||||||||
|
LE CALENDRIER MANUFRANCE
|
||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
|
LIEUX DE MÉMOIRE, LEÇON DE PUB. En
1997 France Culture consacra une émission "Lieux de mémoire"
au catalogue Manufrance. Ce même catalogue dont Alexandre
Vialatte disait s'être inspiré, car il contenait "un ramassis
de choses grandes et magnifiques".
Le
catalogue Manufrance marqua nombre de natifs d'avant 1970,
il restera un objet de mémoire dans le sens ou nous sommes
nombreux à avoir un souvenir particulier ou une évocation
proustienne se rapportant à son feuilletage. Mais, il est
fortement lié à la fois à la revue du Chasseur Français et
au calendrier, une sorte de triptyque ou de trilogie.
L'association de ces trois éléments fût d'une efficacité commerciale
remarquable pour maintenir le nom d'une marque à l'esprit
des clients potentiels. Si le catalogue ou le chasseur français
pouvait se retrouver dissimulé dans un tiroir, le calendrier
était toujours visible, distillant son astuce journalière
et ses feuillets publicitaires. On ne pouvait pas ne pas penser
à Manufrance, la revue faisait la réclame pour les produits,
le catalogue et le calendrier, qui lui-même faisait la publicité
pour la revue, le catalogue et les produits.
Le catalogue universellement connu, collectionné, dont certains
exemplaires sont réédités, et le Chasseur Français, qui existe
toujours, célèbre aussi pour ses petites annonces, ont leur
existence propre malgré la disparition de l'enseigne historique,
même si la société Manufrance existe toujours aujourd'hui
sous une autre forme.
Des trois éléments le calendrier est celui qui a laissé le
moins de trace, même si les tableaux de fond sont collectionnés,
et peuvent aussi jouer un rôle d'objets mémoriels, les éphémérides
comme leur nom l'indique sont éphémères et ont disparu au
fil de leur effeuillage journalier. Le calendrier était le
plus présent quotidiennement, et a disparu d'un coup le 31
décembre 1979.
Il
méritait bien quelques pages sur internet.
HISTORIQUEDe
1922 à 1979, la Manufacture Française d'Armes et Cycles de
Saint-Étienne, et plus tard Manufrance, proposa à ses clients,
ainsi qu'aux lecteurs de la revue " Le Chasseur Français",
un calendrier éphéméride sous la forme d'une gravure, accompagné
d'un calendrier à effeuiller.
Les
calendriers de l'année à venir étaient annoncés et proposés
à la vente dans le numéro de décembre de la revue du Chasseur
Français.
Des
annonces insérées dans les feuillets de l’éphéméride à partir
du mois de novembre rappelaient aussi qu'il était temps de
commander son calendrier.
Ce
sont les annonces parues dans le Chasseur Français qui sont
présentées ici, classées par décennies. Elles montrent la
gravure prévue avec indication de l'année, permettant ainsi
de dater précisément chaque calendrier.
Dans les galeries photo, chaque annonce publiée en monochrome,
jusqu'en 1965, est suivie d'une vue du calendrier en couleur,
lorsque j'en possède un exemplaire.
Sous
l'étiquette "L'éphéméride", vous pourrez voir quelques exemples
de feuillets détachables, avec leurs fameuses astuces du jour.
Il n'y eut pas d'édition du calendrier en 1938, à cause d'un
mouvement de grève à la Manufacture qui dura du 3 août au
8 novembre 1937. La publication du chasseur Français fut aussi
perturbée par cette grève, puisqu'il n'y eut qu'une seule
parution regroupant les numéros des mois de septembre à décembre.
Le
chasseur Français cessa sa publication de 1942 à 1946 en raison
de la guerre, mais il semble que la publication du calendrier
cessa dès 1941 et ne reprit qu'en 1950, en tous cas je n'en
ai pas trouvé trace entre ces 2 dates. Pour le retour du calendrier
en 1951, l'annonce parut dans le numéro de novembre 1950 de
la revue.
Ensuite, ce calendrier fut disponible tous les ans jusqu'en
1979. En 1980, Manufrance dépose le bilan, vend le Chasseur
Français, et le calendrier disparaît après avoir, pendant
plus de 50 ans, décoré les intérieurs de milliers de foyers
français.
Après
quelques tentatives de relance, la liquidation judiciaire
de Manufrance est prononcée en 1985. Manufrance est relancé
en 1988, et fonctionne aujourd’hui avec la vente par correspondance
par un site internet et un magasin à Saint-Étienne, mais sans
le calendrier.
IMPRESSIONS ET IMPRIMEURS
|
||||||||||||||||||